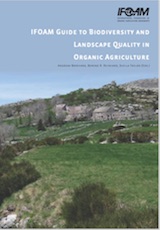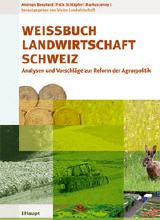(VA) Les quatre services essentiels à une biodiversité intacte dans l’agriculture sont la pollinisation, l’interaction entre nuisibles et auxiliaires, la fertilité du sol et un pool génétique diversifié de variétés résistantes. Tous ces services écosystémiques contribuent à garantir des rendements prospères et stables et à diminuer les influences environnementales tels que les effets du changement climatique par exemple. La sécurité de l’approvisionnement en matière de production alimentaire de la Suisse pourrait déjà diminuer nettement pour la prochaine génération si la perte continuelle de la biodiversité ne peut pas être enrayée. C’est pourquoi il est important de ne pas opposer les objectifs de la sécurité de l’approvisionnement et de la biodiversité, mais de les considérer comme un tout. Faute d’une biodiversité fonctionnelle et de qualité, il sera en effet de plus en plus difficile de garantir une production stable dans l’agriculture.
Influence de la pollinisation sur les rendements des pommes, des cerises et des framboises
En considérant les faits ressortant des rapports nationaux, il faut se rendre à l’évidence : la biodiversité en Suisse ne va pas bien du tout. De nombreuses espèces de plantes, d’insectes, d’oiseaux, de champignons, d’algues et de lichens ont déjà disparu localement, voire complètement. Plus de la moitié des espèces sont du moins potentiellement menacées : chez les insectes par exemple, ce sont environ 60 %. Les nouveaux chiffres du Dr Andreas Müller, Natur Umwelt Wissen GmbH, relatifs aux abeilles sauvages révèlent une diminution drastique des espèces. Parmi les 613 espèces d’abeilles sauvages évaluées, 277 doivent désormais figurer sur la Liste rouge. En comparaison avec d’autres groupes d’organismes évalués, 57 des espèces ont disparu, ce qui représente une part très élevée. La proportion élevée d’espèces d’abeilles sauvages menacées et éteintes serait liée aux exigences élevées de ces insectes en matière de ressources alimentaires et de nidification, qui se trouvent en outre souvent dans différents habitats, séparés les uns des autres. Ces nouvelles données montrent que les mesures prises jusqu’ici pour maintenir la biodiversité n’ont, à elles seules, de loin pas l’effet nécessaire sur les populations d’abeilles sauvages. Les services de pollinisation de toutes les espèces d’abeilles réunies sont presque aussi importants que ceux des abeilles mellifères.
La mort des abeilles sauvages a une influence directe sur les rendements des plantes cultivées. Plusieurs études démontrent l’importance de ces pollinisateurs et leur influence sur la production agricole. Dans une étude réalisée en 2021, l’Agroscope constate ainsi déjà un recul de 30 % des rendements en ce qui concerne les cerises, les framboises et les pommes. Les fèves, qui constituent un apport important de protéines, tant dans l’alimentation humaine qu’animale, dépendent fortement des services de pollinisation des bourdons, qui appartiennent à la famille des abeilles véritables. Cela principalement en raison du fait que les fèves fleurissent très tôt dans l’année, lorsque les abeilles mellifères ne volent pas encore. Une étude du FibL indique en outre les mesures concrètes nécessaires dans l’agriculture pour favoriser les abeilles sauvages de manière ciblée. Des chiffres relatifs à la valeur économique ont également été recueillis. Les connaissances sont là – reste la question suivante : de quoi a-t-on besoin pour que ces connaissances soient mises en œuvre dans la pratique ? Ici, des décisions politiques lucides sont aussi nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire de notre pays à long terme.
Une fertilité du sol accrue grâce à davantage d’organismes vivants du sol
La biodiversité du sol est décisive pour l’assimilation de nutriments par les plantes, et donc essentielle à la production agricole. La plupart des fonctions du sol sont contrôlées directement ou indirectement par les organismes vivants du sol. Une grande diversité biologique dans le sol est l’une des conditions nécessaires pour une grande biodiversité en surface, une meilleure élimination du matériel végétal mort, une meilleure disponibilité des nutriments et une réduction des émissions de protoxyde d’azote du sol. En fin de compte, sans les organismes vivants du sol, aucune production de denrées alimentaires n’est possible, car ceux-ci garantissent le maintien des fonctions de production et de régulation du sol, en particulier sa teneur en eau et la transformation des substances organiques. L’été dernier, durant la longue période de sécheresse en Suisse, le constat a été le même partout : sur les surfaces à haute teneur en matière organique et comptant donc un grand nombre d’organismes vivants du sol, l’eau était conservée plus longtemps dans le sol, ce qui avait une influence positive directe sur les récoltes.
Interactions entre nuisibles et auxiliaires et pool génétique
Les résultats de différentes recherches démontrent l’importance des insectes et des araignées dans la régulation naturelle des nuisibles dans les cultures agricoles. Ces prédateurs, qui se nourrissent d’une grande partie des nuisibles, peuvent être favorisés par des mesures spatiales sur l’exploitation et des formes d’exploitation adaptées. Cela signifie concrètement que les zones exploitées pour l’agriculture ont besoin de nombreux habitats riches en fleurs pouvant fournir de la nourriture aux auxiliaires à différentes périodes de l’année. Il s’agit de prairies extensives, de haies, de lisières forestières, des bandes fleuries et des lisières. Ces dernières jouent un rôle peu spectaculaire mais très important à cet égard, car elles relient deux types d’habitats, par exemple des plantes vivaces entre forêt et prairie. Les syrphes jouent notamment un rôle important dans le contrôle des nuisibles. Leur avantage réside dans le fait qu’ils apparaissent tôt dans l’année et peuvent ainsi déjà agir contre les premiers nuisibles. Ils hivernent dans des prairies extensives, des jachères ou des lisières. Or ces habitats diminuent si vite et si drastiquement que les syrphes font partie des insectes fortement menacés.
La biodiversité joue également un rôle important dans la sélection des espèces cultivées. La diversité génétique est utilisée et façonnée dans ce but. En matière de variétés cultivées, le pool génétique des anciennes variétés du pays est crucial pour la conservation de la diversité génétique. Plus la diversité génétique d’une espèce est élevée, mieux elle peut s’adapter à de nouvelles réalités, dans la mesure où celles qui présentent un avantage survivent. Dans le cadre du changement climatique, justement, il est important, par exemple, de miser sur des espèces résistantes à la sécheresse.
Le rôle de l’agriculture
L’agriculture est ainsi à la fois bénéficiaire de la biodiversité et l’un des principaux moteurs de la crise de la biodiversité. En Suisse, les principaux facteurs entraînant la perte de la biodiversité sont les apports en nutriments trop élevés dus à l’élevage intensif, l’utilisation étendue d’engrais, la forte pollution due aux pesticides et, de manière générale, les cultures extrêmement intensives. Une réflexion et une action globales sont nécessaires pour pouvoir encore enrayer la crise de la biodiversité. Un exemple : une bande de jachère florale le long d’une grande culture ne sert pas à grand-chose si les insectes qui s’y trouvent succombent aux pesticides provenant de la culture ou si les apports en nutriments dans le sol sont si élevés que les plantes essentielles aux abeilles sauvages ne peuvent s’y établir. Pour que la biodiversité fonctionnelle en particulier puisse aussi être préservée, les connaissances de ces corrélations doivent être intégrées et diffusées beaucoup plus largement. De nombreux agriculteurs et agricultrices se soucient déjà beaucoup de la biodiversité dans leurs exploitations. Ils accomplissent ainsi une tâche essentielle, non seulement pour leur exploitation, mais pour toute l’agriculture. Ils ont cependant besoin de davantage de soutien de la part de la politique agricole et des associations.
« Case » biodiversité en politique
La PA22+ n’apporte que de faibles améliorations en matière de biodiversité. Aucune mesure n’est notamment prévue pour améliorer la qualité de la biodiversité sur les surfaces déjà existantes. Les 3,5% de surfaces de promotion de la biodiversité dans les grandes cultures proposées par le Conseil fédéral et expressément soutenues par le Conseil national apporteront des améliorations. La trajectoire de réduction des émissions de lisier et d’ammoniac, qui s’attaque principalement au problème des excédents de nitrates, a toutefois été revue à la baisse au Parlement. Cela signifie que d’ici 2030 (une révision de la politique agraire n’est prévue qu’alors), aucune amélioration ne sera apportée par la politique agricole, précisément en ce qui concerne l’azote et la protection du climat. Pourtant, il existe de nombreuses solutions, comme des adaptations telles que l’intégration obligatoire des analyses de sol dans les plans de fumure ou des taxes d’incitation sur les engrais chimiques et les fourrages, afin de réguler la pollution azotée en Suisse. L’association des paysans et paysannes pratiquant la production intégrée (IP Suisse) a renforcé son programme de points dans le domaine de la biodiversité, car elle est convaincue que la biodiversité doit être davantage encouragée dans les exploitations IP.
La contre-proposition à l’initiative sur la biodiversité élaborée par le Conseil national sera traitée prochainement par la Commission de l’environnement du Conseil des États. Grâce à cette révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, les agriculteurs et agricultrices peuvent s’engager de manière ciblée en faveur de la biodiversité, notamment dans de nouvelles zones de biodiversité alliant protection et utilisation. La révision prévoit 96 millions de francs de plus pour la biodiversité suisse, en grande partie destinés aux exploitations agricoles. Mais il ne suffit pas de préserver la biodiversité sur les terres cultivées. Les forêts aussi, et particulièrement les zones habitées, requièrent des mesures additionnelles urgentes d’ailleurs prévues par la révision de la loi.
Liens / littérature :
La sécurité alimentaire doit être renforcée de manière durable, Albert von Ow, Agroscope :
https://sciencesnaturelles.ch/uuid/i/abd6d773-7069-5b1d-ba4f-e99046bbddfd-«%E2%80%AFLa_sécurité_alimentaire_doit_être_renforcée_de_manière_durable%E2%80%AF»
Dossier Biodiversité, Forum Biodiversité Suisse
https://sciencesnaturelles.ch/biodiversity
L’habitat des insectes renforce la pollinisation et la production agricole, Matthias Albrecht, Agroscope
https://sciencesnaturelles.ch/uuid/i/978d7c67-3032-53e2-b3ac-cfda16bb2ab1-Lhabitat_des_insectes_renforce_la_pollinisation_et_la_production_agricole
Mesures des valeurs économiques des services de pollinisation :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041614001156
Hotspot Biodiversité du sol, SCNAT
https://portal-cdn.scnat.ch/asset/64d91143-1263-5592-bdb7-17a6dfc500b8/hotspot%2032%20fr%20WEB.pdf?b=84578460-aff0-591d-b2ba-62a122573b96&v=2fcd42d6-cf11-556c-8558-957f56f0ac92_0&s=nEv8xyNuuDFCivRFKm8NRMd_wSkS9SQgT1Jw4C2myY03MAz6CobgmDACfeG2WitDqu2XRgxE8JjzLxYWh2FG5tUVtAqNBv9BJVmnNHEJLx3I-_Ul8atTlnUqzafpvwCwB4ALoPepYGe04YmjSJpu4vRJQUrzuZ8HkFdOHY_yJkY
Évaluation des fonctions du sol, Centre de compétences sur les sols
https://ccsols.ch/fr/utilisation-durable-et-protection/evaluation-des-fonctions-du-sol/
Favoriser les auxiliaires de cultures, Agridea
https://www.gutelandwirtschaftlichepraxis.ch/fileadmin/user_upload/Favoriser_les_auxiliaires_de_cultures.pdf
Syrphes (en allemand)
https://www.nabu.de/news/2020/10/28880.html
https://www.wwf.de/themen-projekte/artensterben/insektensterben